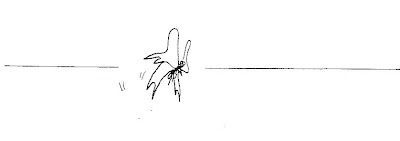Françoise TOMENO
Illustrations Clémence BERGER*, 1991
Cahier de l’EPIC**n°7 – Septembre 1991
I – Ainsi fût-elle baptisée Papillon
Une rentrée scolaire dans les années 1980. Ils ont 3, 4, 5 ans, ils ont déjà été à l’école pour certains. Ils sont un tas de petites personnes sans nom, dont on dirige les pas vers une drôle d’école très loin, enfin pas à côté de la maison, où on ne retrouve ni ses frères, ni ses sœurs, ni le petit gars d’à côté, ni la copine d’en face.
Mais pourquoi si loin ?
Mais pourquoi n’ont-ils pas de nom ?
Pour la même raison ! Ça vous étonne ? Eh bien entendez bien, ils sont sourds. Quand on est sourd, qu’on a 3, ou 4, ou 5ans, l’inquiétude de vos papas-mamans qui vous bat les flancs, le désarroi d’une maîtresse qui a fait ce qu’elle a pu, et parfois pas grand-chose, et l’embarras proche de la sidération devant toutes ces lèvres qui s’agitent, ces regards et ces postures qui exigent que vous en fassiez autant, quand on a tout ça et pas grand chose pour le penser, et qu’on ne comprend pas les effets d’une différence qu’on ignore, eh bien on va « dans-une-école-spécialisée ». Et quand on arrive, on ne sait pas qu’on s’appelle Jules, Léontine ou Irma, on ne sait pas qu’on s’appelle tout court. Qu’on s’appelle et qu’on s’appelle. Je veux dire, que quelqu’un vous a attribué un prénom et que vous portez un nom, dans le meilleur des cas celui de votre père, et qu’on peut vous interpeller en prononçant l’un ou l’autre sans que vous voyiez votre « héleur ». Et pour cause, c’est du jamais entendu.
Pourtant vous n’avez pas manqué d’être appelées, petites personnes, dans l’angoisse et la terreur de la part de vos proches, qui ont élevé la voix, qui ont désormais chevillé au corps la peur de ne jamais se faire entendre de vous, de vous découvrir si différents qu’ils se demandent d’où il vient, ce sauvage petit canard. Et ça n’est pourtant pas faute de voix de vote part. Comme les autres, en arrivant au monde, vous avez crié. Mais cette voix-là est restée rauque, inélégante, sans ressemblance avec des berceuses et des comptines que vous n’avez jamais entendues. Cette voix qui se fait cris quand vous insistez pour demander, pour demander qu’on vous parle, pour dire l’insupportable de ne pas être compris.
Cette voix qui n’a jamais prononcé le nom de « maman » de « papa », des frères et sœurs.
Et vos mamans, elles sont là, désolées de ne pas avoir été reconnues et nommées, et vos papas, ils sont là sans se reconnaître dans cet engendrement tordu. Et vos frères et sœurs ? Ils ont cette chance d’avoir pu partager avec vous le temps des histoires sans paroles. Mais vite la honte s’est emparée d’eux.
Au moment où progressivement vous vous contentiez de désigner les objets pour les demander (« on se comprend » disent les papas mamans), où on vous désignait les lieux où vous deviez aller, en ce temps-là de la désignation, arrivait celui aussi où l’on vous désignait sourd, enfin plutôt « le sourd ». Un nom est toujours plus dur à porter qu’un adjectif quand il véhicule l’insulte. Le nom, ça vous colle à la peau ; l’adjectif, il peut être accompagné d’autres moins désobligeants, ou disparaître au profit d’autres qui témoignent du changement.
Désigné sourd, désignant les objets : et pourtant pendant toutes ces années de désarroi réciproque, mais non partagé, vous n’avez pas été sans entendement et sans pensée, vous avez été pris dans des adresses qui, pour autant qu’elles étaient tordues parce qu’embarrassées, n’en portaient pas moins des souhaits de vie. Et c’est sujet de vos cris que vous êtes devenus, sujets y entendant bien quelque chose à tout ce bazar.
Et vous voilà un 1er Septembre au seuil de ce bâtiment tout neuf, accompagnés de papas et de mamans, ou de mamans tout court, qui viennent réclamer « qu’il parle » comme on prononce un oracle, et « qu’il apprenne » (y’a qu’à pas le faire jouer, et à la place le faire apprendre, rattraper le temps perdu).
Le faire faire,
le faire apprendre,
le faire jouer,
le faire parler,
mais le faire faire
comme on le ferait chier
Dociles ou pas, vous voilà en position de devoir faire des mots comme on fait un caca d’une part, mais aussi comme un leurre de ressemblance qui va venir colmater ces appels impossibles, ceux du nom, signes d’appartenance de votre filiation et de votre baptême, et ceux de l’appel de loin qui vous aurait laissé la possibilité de ne pas répondre. Alors, vous allez vous débrouiller et inventer : pour ne pas répondre, je vous passe le tuyau, vous fermez les appareils auditifs, et vous faites semblant d’être très absorbé. Efficace, et ça agace, mais ça agace… l’adversaire. Seul moyen de ne pas répondre à l’appel, à celui qui se fait exigence de – montre moi que t’es pareil que moi, parle, dis des mots (les phrases on s’en fout) et dis-moi un deux, trois, quatre, et le chat, la pipe, l’auto, etc.…
Pas d’autre issue pour résister à l’intrusion du faire parler que de faire la sourde oreille.
Alors nous y voilà, à ce matin de Septembre : Jules, Léontine, Irma et les autres, qui ne savent pas qu’ils s’appellent comme ça, et Dupont, Durand, etc… arrivent, pleurent un grand coup parce que maman s’en va et qu’ils n’ont aucune idée de quand elle revient, et même, tiens, est-ce qu’elle revient ? …
Ça alors, et où je dors ce soir, et est-ce que quelqu’un vient me chercher ? Et c’est où chez moi : pas près d’ici, ça je l’ai vu. Et elle, la maîtresse, est-ce qu’elle va me demander la même chose que tous les autres? C’est classé, c’est sûr.
Mais, ils sont drôles les gens ici, ils font des trucs avec leurs mains. Ben, pourquoi en regardant la petite, là, elle, la maîtresse, elle fait comme si elle avait deux couettes. Ah, tiens, elle a deux couettes, la fille.
Et lui ? La maîtresse et la fille à côté, enfin la dame, elles se marrent, elles mettent leurs mains devant leurs yeux, elles abaissent et remontent leurs doigts plusieurs fois : ça je vois pas bien ce que c’est.
Ah, maintenant elles regardent cette drôle de petite fille qu’à l’air tout à fait épuisé (remarquez elle fait rien de la journée, c’est pas pour dire) et qu’à des yeux bridés : eh ben tiens ! C’est ça qu’elles font avec leurs mains : elles suivent avec deux doigts le tour des yeux en remontant comme eux.
Ah, ben c’est mon tour, maintenant. Ça devait arriver. Elles m’énervent. D’ailleurs, ils m’énervent tous depuis toujours. Elles vont encore me dire quelque chose que je vais pas comprendre. Comme les autres, elles sont ! Je le sais bien, ils sont tous pareils. Et qu’est-ce qu’elles font cette fois ? Ça alors, elle font un drôle de truc, je peux pas le dire ; tiens, comme ça :
et c’est à moi qu’elles FONT ça ? C’est quoi ça ?
Et Irma ne tardera pas à le savoir, ce que c’est, ça : PAPILLON, comme elle papillonne, s’agite, gigote, et ne se laisse jamais prendre à la demande de l’autre, inhabituée qu’elle est qu’elle pourrait, elle, demander à l’autre. Non, c’est impossible. Ils resteront tous des emmerdeurs et pour longtemps.
II – IRMA t’es pas douce
C’est quelques mois après son entrée à l’école « spéciale » que j’ai fait plus personnellement la connaissance d’Irma. Irma passait son temps à s’agiter, échapper aux regards comme aux mains qui voulaient l’attraper, elle désormais nommée papillon pour la vie, à piquer des petits objets qu’elle planquait soigneusement dans le placard de sa chambre, sans s’en cacher pourtant, mais sans non plus l’exhiber, à crier, se coincer dans un coffre, etc.… Elle prenait toujours un vêtement d’un de ses parents et se le gardait des journées entières sur le dos. Comme à l’école, elle adorait se nouer des chiffons et se passer des vêtements destinés au déguisement, on disait que c’était du déguisement. Je pense que c’était une façon de bricoler de l’identification un peu branlante.
Irma la pas douce a eu des maîtresses, une et des orthophonistes, une psychomotricienne etc.… Etc.… et elle m’a eu moi, la psychologue. Et pour m’avoir, elle m’a eue ! … Elle nous a tous eus. On s’est tous plantés : plantés là devant elle, qu’elle nous voyait ! Et plus on adressait et plus elle nous envoyait balader, nous jetant avec l’eau du bain de langage, fût-il gestuel, que nous tentions vainement de lui offrir, ou se jetant elle-même avec, ça marchait dans les deux sens.
Donc, de rééducation en prise en charge, Irma a fini par arriver dans la petite pièce accueillante que je partageais avec mes deux collègues psychiatres. On a quand même travaillé plus d’une année ensemble, et il n’y avait pas rien dans ces échanges.
Prudents et passant par un temps de dessins, bizarrement géométriques, et apparemment non figuratifs, temps pendant lequel, ouf, je lui fichais la paix et ne demandais rien (j’étais un peu sourde, quoi !), ces échanges sont devenus ceux de jeux dont j’étais le témoin ou l’interlocuteur.
Je ne saurais vous en redire toute la chronologie et les détails, mais nous en sommes un jour venues au fait : ce fût le coup du téléphone.
Irma prit plusieurs fois le téléphone, essayant d’articuler quelques sons, et ceux-ci pour une fois adressés à quelqu’un représenté en ce temps-là par moi-même. La psychothérapeute que je tentais d’être approcha du ravissement. Irma, tout en articulant des sons, se mettait à user de quelques signes (de la L.S.F Langue des Signes Française). Elle était en train de guérir et de la même façon que d’autres de ses copains avec qui je travaillais, avec les mots oralisés et les mots signés en même temps, pris dans le mouvement d’une adresse, via les identifications réciproques (j’avais été sourde, elle deviendrait entendante).
Hélas, trois fois hélas !
Un jour le téléphone valsa de l’autre côté de la porte, qu’Irma-Papillon affolée claqua vigoureusement, restant du même côté que moi dans la pièce. Toute cette agitation et ce désarroi et cette colère refirent surface avec violence et c’est moi qui fût décontenancée et impuissante.
La semaine d’après, c’est elle-même qu’elle flanqua à la porte, avec la même violence.
Et elle ne revint plus.
C’est moi qu’elle avait mise dehors.
Dans la même case que tous mes camarades qui avaient aussi essayé de la rencontrer.
Et ça a duré des années. Irma-Papillon était partie pour un long voyage dans un pays où aucun de nous ne pouvait la suivre.
III – Le papillon errant se pose
De fond de classe en fond de classe, de désolation en désolation, Irma franchit tristement les quatre-cinq ans qui suivirent. On essaya bien de faire signe du côté de papa-maman et du frère : on y attendait le miracle de la puberté qui comporterait à coup sûr l’accès à la parole orale, et comme par enchantement, une gigantesque réparation des humeurs, des apprentissages, et, tiens, pourquoi pas, le replâtrage d’une relation de couple où la faille faisait écho à celle de l’arrivée d’Irma sourde dans le foyer.
Et puis, un jour tout bascula. Une initiative institutionnelle permise par divers évènements, circonstances, réflexions, créa le « Groupe Atelier ». Un groupe destiné à accueillir les enfants sourds – pas fous – mal dans leur peau – incapables d’apprentissage – et n’échangeant ni en langue orale ni en L.S.F. – et pour autant jouant et faisant preuve d’une vitalité active.
Pas de priorité scolaire. Une enseignante serait à la disposition du groupe pour des temps de travail individuel au fur et à mesure de l’évolution des enfants.
Priorité à un travail de réseau, avec des éducateurs : associer les déplacements des enfants aux thèmes privilégiés de la filiation, des origines, de l’espace, du temps, et permettre qu’ensuite on en reparle et qu’on travaille sur les traces écrites ou picturales (photos, dessins de ces déplacements) : avec la participation d’un adulte sourd.
Mise en place d’ateliers à supports d’expression en insistant plus sur le travail des échanges et des lieux que sur le contenu (pas d’esthétique obligatoire ni de souhait d’interprétation, ni de production).
Alors ça a démarré pour tous les enfants accueillis dans ce groupe (une bonne dizaine). Au bout de quelques mois, ces enfants étaient devenus souriants et engageants. Ils saluaient dans les couloirs leurs anciens camarades de classes, qui avaient bien tourné, mais plus encore tous ces adultes avec lesquels ils s’étaient trouvés en échec. On entendait dire qu’ils acquéraient de l’humour.
Dans un groupe de réflexion, on s’étonna de leur étonnement. L’un d’entre eux découvrait au cours d’une visite que dans l’immeuble où habitait la famille d’un copain de son groupe, il y avait des gens qui s’appelaient comme lui. Un autre découvrait que … son père et sa mère s’appelaient comme lui. Un troisième commençait à se représenter des trajets et des itinéraires après avoir du emmener ses copains chez lui.
Etc.…
Un enfant qui s’était toujours fait mettre à la porte supportait progressivement de rester à proximité du groupe sans participer à l’activité proposée. Un an et demi plus tard, il y exposerait une de ses premières demandes. Il ferait le dessin d’une maison pour dire que lui aussi il voulait faire une maison en terre ; or, il utiliserait une technique apprise 6 mois plus tôt, technique à côté de laquelle on pensait qu’il était passé.
Parallèlement à ce travail sur les réseaux, il fût demandé aux parents de rencontrer des éducateurs du groupe et un des psy régulièrement (tous les mois et demi environ).
Quand ces rencontres ont pu avoir lieu, c’est toujours cette adoption réciproque parents-enfant sourd qui fut travaillée, au gré des identifications qui permettaient le « Tu es mon fils », en passant par la reconnaissance de la différence, impliquant obligatoirement un travail faisant aller de la blessure narcissique au « pas tout » de la castration.
Et en réponse, ces enfants commençaient à interpeller avec leur voix leurs pères, mères, frères et sœurs etc.… Certains pouvaient déjà les désigner vocalement, mais rarement les interpeller. Quel travail d’identification pour un sourd que de produire un son qui va faire se retourner l’autre, alors que lui-même ne s’entend pas le produire. Faut-il avoir idée que l’on va être un tant soit peu entendu !
C’est ce qui arriva à notre papillon affolé. Six mois après la mise en place de ce Groupe Atelier, ce furent les vacances d’été.
Quand nous rencontrâmes ses parents après la rentrée de septembre, la maman était bouleversée. Elle avait entendu, pour la première fois de sa vie, sa fille l’appeler « maman ». Irma avait 12 ans !..
Tout alla très vite. Irma s’intéressa à la L.S.F. Elle commença à se mettre à l’ouvrage scolaire. Plusieurs mois passèrent.
C’est à ce moment-là que je rencontrais pour la deuxième fois Irma. Je devais, administration oblige, lui faire passer un test ; j’hésitais, poursuivie par mes mauvais souvenirs. Je risquais le coup. Irma vint, pas affolée, à l’aise dans la place de quelqu’un qui est interrogé, dans la place d’élève.
Mission accomplie. Je remercie Irma et lui dis que c’est fini.
Elle me dit: "Attends".
… Va chercher le téléphone, qu’elle décroche, et tout en le tenant, fait le signe « ami », parle avec sa voix dedans, tout en me regardant, une parole incompréhensible bien sûr, mais pas fictive comme dans le temps. Je venais de m’adresser à elle en signes, témoignant de ce désir mis en œuvre dans l’institution, de reconnaître sa différence et sa particularité, et ce qu’elle me disait au téléphone, c’était qu’elle sourde et moi entendante, nous avions quelque chose à nous dire.
J’étais très émue, puisqu’elle reprenait nos échanges très exactement là où ils en étaient restés : avec le téléphone. Quelques années auparavant, il disait l’impossible rencontre ; aujourd’hui, il l’engageait.
Je proposais donc à Irma de nous revoir régulièrement, elle acquiesça volontiers.
Les séances qui suivirent, elle nous fit jouer plusieurs fois deux scènes : l’arrivée d’un enfant sourd dans une école pour sourds, et la situation de classe. Il fallait à chaque fois inverser les rôles. Je vous livre deux moments clés de ces échanges.
Je suis la mère. Je viens demander à Irma que je pense être le directeur, s’il veut bien accueillir mon enfant sourd. Je suis surprise par la rapidité de la réponse. Elle est catégorique. C’est non, il n’y a pas de place pour mon enfant sourd.
Alors, je rentre dans une colère noire, je tempête à force de gesticulations et d’explications en L.S.F. Comment, c’est une école pour sourds, mon enfant est sourd, et il n’y a pas de place pour lui ici ? Ce n’est pas normal, etc…
Irma est aussi décontenancée par ma soudaine violence que je l’ai été par sa réponse. Une fois encore elle me dit « attends » et prend le téléphone ; je comprends alors qu’elle s’adresse au directeur qu’elle n’était pas, ou qu’elle n’est plus, et plaide la cause de mon enfant. Souriante, elle raccroche et me dit « c’est d’accord, le directeur a dit oui ».
À qui avais-je donc affaire,
Peut-être une psychologue ?
Deuxième scénario : je suis élève, j’ai fait des conneries et je suis convoquée chez le directeur.
Je me surprends à être tout à fait comme le papillon d’antan (j’allais écrire « d’entends » !...), je gigote, je gueule, je suis renfrognée, je ne me laisse pas attraper. Le directeur alias Irma me fait asseoir, me croise les mains comme dans le signe « prison » et me demande d’écrire les mains ainsi liées, mon nom ! …
Je suis sidérée : les mains liées, comme elles le sont dans le mot « papillon » comme elles l’étaient pour cette petite fille sourde, elle dont les mains se délient aujourd’hui.
Là où ça s’est compliqué, c’est quand Irma m’a demandé d’échanger les rôles, comme nous en avions coutume, et m’a impérativement demandé que je l’oblige à écrire les mains « emprisonnées » : je ne pouvais pas, je ne voulais pas, c’était trop violent.
Mais il a bien fallu aller au bout pour que cette réminiscence devienne souvenir partagé.
J’étais, bien entendu, bouleversée.
Peu après, des vacances arrivèrent. Au retour, Irma me signifia clairement qu’elle ne voulait plus venir. Avions-nous bouclé quelque chose ? Il semblait bien. Irma papillonnait pour aller se poser là où il y avait pour elle de la rencontre et de la curiosité.
Les rencontres avec les parents d’Irma devenaient délicates. Ils faisaient état de leur projet de se séparer, et de faire coïncider le départ d’Irma dans une institution pour sourds plus âgés avec le moment de leur séparation. J’avais l’impression qu’on allait refaire le premier coup du téléphone : jeter le bébé avec l’eau du bain.
Entêtés dans notre intention d’aider tout ce monde, nous avons travaillé.
Aujourd’hui les parents d’Irma se sont séparés, mais celle-ci ne quittera l’établissement qu’en fin d’année scolaire, normalement.
Au début, l’idée de la séparation l’a affolée au point qu’elle ne parlait plus que de ça à tout le monde. Grâce à une entente de tous, on lui a proposé de venir à sa guise m’en parler. Quelques mois plus tard, elle vivait à peu près en paix cet évènement.
Si les mains se séparent, c'est pour mieux se lier, et si elles se lient, c'est pour pouvoir se délier.
Comme la parole.
Madame Tomate, un dimanche d'avril 1991
Mais pourquoi Madame TOMATE?
Figurez-vous que c’est mon patronyme en sourd. Enfin, pas tout à fait, c’est plus exactement «Joues rouges comme une tomate ».
Et pourquoi ça ? Parce que je rougis facilement ? Bien sûr.
Mais pas que pour ça.
Ça commence avant.
Un prénom, en sourd, je vous l’ai décrit au début, c’est un signe caractéristique de la personne, une description (« celle qui a maigri »), un détail (« les taches de rousseur »), une qualité (« le fort »), etc… c’est visuel.
Et comment vous visualiseriez TOMENO ? On peut toujours l’épeler, mais c’est vraiment trop long.
Eh bien, c’est étonnant : les sourds construisent un signe-patronymique associant à la fois l’articulation du nom par les lèvres.
Et une caractéristique de la personne (« qui rougit comme une tomate »).
Quant à moi j’aurai donc gagné un drôle de nom au moment où les mains d’Irma se déliaient. Ce qu’il fallait faire pour qu’elle vole, de ses propres ailes, vers ce qui lui semblerait bon, et qu’elle cesse d’errer et de se débattre comme dans un filet, exigeait que je m’habille d’un vêtement de sourd en acceptant d’être moi aussi nommée par les sourds.
* Clémence BERGER: http://clemenceberger.jimdo.com/
** EPIC, Ecole de Psychiatrie Institutionnelle de La Chesnaie